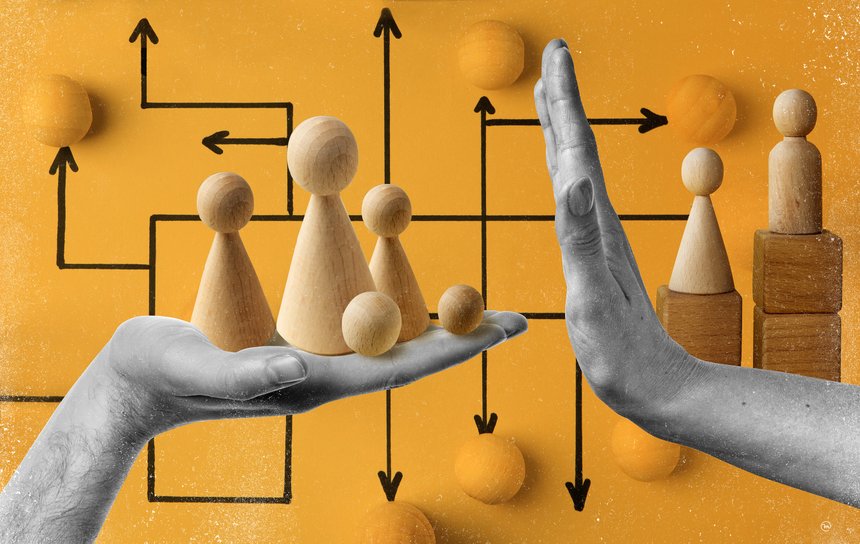Lundi 6 novembre 2023. Au tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne), le recours en référé déposé par plusieurs associations à l’encontre du préfet se solde par un rejet. Objet du contentieux : la fin de prise en charge et la remise à la rue de personnes hébergées à l’hôtel. Les 658 personnes – dont 311 enfants – sans solutions de relogement depuis mai dernier resteront donc dehors, la décision de justice ne reconnaissant pas le caractère urgent de leur situation, au motif que les requérants ont tardé à saisir la juridiction. « D’après les équipes mobiles, beaucoup de familles se cachent dans des squats ou à l’aéroport. Il s’avère désormais difficile de les rencontrer pour les accompagner alors qu’elles sont davantage précarisées, voire en danger », pointe Anne-Claire Hochedel, déléguée régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Occitanie, partie prenante du recours. Une mobilisation loin d’être isolée. En octobre, la ville de Bordeaux a, elle aussi, engager un recours pour que l’Etat assume ses obligations. Autre exemple : le 22 novembre, le conseil municipal d’Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne) a voté une délibération pour interpeller sur les mises à la rue illégales et le manque de moyens.
Si, à Toulouse, une procédure « classique », avec un jugement sur le fond, se tiendra dans les mois à venir, ce premier verdict confirme un paradoxe récurrent observé par les professionnels du secteur de l’hébergement d’urgence : les limites du droit à l’accueil inconditionnel pour toute personne sans abri et en situation de détresse. Et, avec elles, l’interdiction de remise à la rue consacrée par le code de l’action sociale et des familles (CASF). « Notre requête révèle la problématique de décisions administratives non assumées mais induites par des courriers individuels envoyés directement dans les hôtels sociaux par la préfecture. Les motifs de la décision ainsi que les recours possibles n’y étaient pas mentionnés. Cela pose question », précise la déléguée régionale de la FAS. Un manque de clarté et une incohérence d’actions qui impactent les travailleurs sociaux, dont la mission est d’accompagner des usagers vers une situation stable et pérenne.
Dans un contexte où le nombre de personnes sans abri a doublé sur la dernière décennie – 330 000 individus sont actuellement privés de toit, selon la Fondation Abbé-Pierre –, les solutions transitoires d’insertion vers le logement se multiplient. Un phénomène inédit, qui se traduit par des budgets à la hausse depuis quinze ans. Ainsi, entre hébergements collectifs, appartements en diffus et hôtels sociaux, environ 203 000 places d’accueil ont été financées en 2023 dans le secteur dit « de droit commun ». Pourtant, chaque soir, plus de 8 000 personnes – dont près de 3 000 mineurs – se voient refuser une mise à l’abri par les services départementaux des pôles du 115 au sein des services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO). A Paris, où la tension est particulièrement marquée, le numéro d’écoute gère quotidiennement 650 places d’hôtels, en lien avec l’opérateur Delta, gestionnaire de l’offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France. « Les salariées régulatrices étudient le profil des familles en demande car un système de priorisation au regard du nombre de places disponibles est établi », révèle Maryse Ramambason, coordinatrice au pôle « travail social » du 115 de la capitale.
Sélectionner les vulnérabilités
Le tri repose sur une échelle de vulnérabilités établie par la préfecture et la Drihl (direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement), le financeur principal. Une échelle dont le contenu et la provenance diffèrent d’un territoire à l’autre. A Paris, la priorité va aux femmes enceintes de plus de sept mois, aux nourrissons de moins de 3 mois, aux ménages comportant une personne à mobilité réduite et à ceux composés d’un individu atteint d’une pathologie grave « incompatible avec la survie à la rue », par exemple un cancer. Ces critères autorisent une mise à l’abri à la nuitée, pour intégrer ensuite, si la disponibilité dans le contingent le permet, une chambre pour sept jours.
« On a affaire à un public de plus en plus précaire puisque les durées de vie en errance s’allongent. La situation de femmes enceintes ou de nouveau-nés sans solution s’avère non acceptable pour les équipes », poursuit la coordinatrice. D’autant que les difficultés s’accentuent avec l’arrivée de l’hiver. « Tout ceci pèse sur le quotidien des agents, peu nombreux pour gérer ces urgences et dont le métier manque cruellement de reconnaissance », alerte Maryse Ramambason. Résultat : tous profils confondus, parmi les appelants, un millier de personnes se voit refuser, chaque soir, un hébergement. L’augmentation de plus de 40 % des visites au sein des accueils de jour des dispositifs de veille sociale de la Ville de Paris durant les derniers mois ainsi que la tension observée dans certains hôpitaux où les sans-abri tentent de se maintenir pour se protéger confirment la dynamique délétère à laquelle sont confrontés les professionnels.
En province, les enjeux se révèlent identiques. Quotidiennement, de nombreux travailleurs sociaux se voient contraints de rejeter la demande d’accueil d’une partie du public, que ce soit au sein des SIAO ou des dispositifs censés prendre le relais sur un contingent d’urgence saturé. « Nous ne sommes pas une structure d’hébergement d’urgence mais un dépannage, la cinquième roue du carrosse, le bout du bout », pointe Mathias Biver, intervenant social à la halte de nuits pour femmes gérée par l’association Les Eaux vives Emmaüs, en Loire-Atlantique. « Lorsque des femmes ne trouvent pas de solution, nous proposons un accueil d’une nuit grâce à 15 places en chambres collectives. Pourtant, nous sommes contraints d’imposer des refus tous les soirs, et c’est de pire en pire. Nous avons été obligés d’instituer des critères, sinon on ne s’en sortait pas. Mais tous les soirs, c’est le pincement au cœur », confie-t-il.
Humainement très dur
Ces refus quotidiens marquent les professionnels, forcés d’assumer des responsabilités qui les dépassent. « Toutes les femmes que nous accueillons ont été victimes de violences. On ne peut pas s’habituer à ce tri perpétuel et désormais obligatoire, souligne Sabrina Cairo, référente sociale pour la halte-nuit. C’est difficile car nous ne sommes pas là pour enquêter et nous travaillons sur la base de données déclaratives. Nous tentons de faire entrer de nouvelles personnes pour les informer sur les dispositifs locaux qui pourraient les aider, en fonction de leur situation administrative. Mais c’est humainement très dur de devoir expliquer à des femmes isolées qu’elles vont devoir dormir dehors. »
En cause notamment dans ces dysfonctionnements, le sous-dimensionnement du dispositif national d’accueil (DNA). Ce dernier permet aux demandeurs d’asile et aux réfugiés statutaires dépourvus de ressources suffisantes d’être accueillis dans des structures spécialisées telles que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) ou les centres provisoires d’hébergement (CPH). Cheffe de service de la veille sociale pour l’association Renaître, située à Saint-Etienne (Loire), Magali Rousset s’inquiète : « Nous n’avons pas eu de possibilités d’héberger l’été dernier. Aussi, de nombreuses familles appellent le 115 alors qu’elles relèvent du DNA. Elles parviennent parfois à être mises à l’abri par un dispositif inadapté à leurs besoins. Les efforts de l’Ofii [Office français de l’immigration et de l’intégration] pour rendre disponibles le maximum de places ne suffisent pas. » Pour preuve, le rapport « L’asile en France et en Europe, état des lieux 2023 » de l’association Forum Réfugiés indique que moins de la moitié (40,8 %) des 142 940 demandeurs d’asile enregistrés étaient hébergés dans un lieu dédié fin 2022.
Des hébergements saturés
A cette réalité s’ajoute la pression engendrée par la mise à l’abri des personnes en situation administrative irrégulière, dont le nombre est estimé à 100 000 au sein des structures d’urgence. « Une partie de cette population pourrait être éligible au titre de séjour et, en allant travailler, pourrait se loger. Nous savons d’expérience que, lorsqu’il est inséré professionnellement, il s’agit d’un public autonome qui sort rapidement de nos dispositifs », assure la cheffe de service. Mais en pratique, que ces personnes aient un emploi ou pas, le lien entre l’hébergement et le logement social, une pension de famille ou une sous-location via l’intermédiation locative n’est pas autorisé quand les droits sont incomplets. Ce qui explique que les dispositifs s’enkystent, avec des temps d’hébergement qui durent parfois plusieurs années. « Orienter les personnes sans papiers sur les mêmes structures présente le risque d’empêcher le reste du public d’obtenir une place. Il reste que, en raison des critères appliqués, une personne isolée et en situation irrégulière n’a aucune chance d’accéder à un hébergement », affirme Magali Rousset.
L’embolisation tient également à la précarité et à la fragilité d’un public difficile à accompagner vers l’insertion. « Il est complexe d’accompagner lorsqu’on dépend de services publics souvent à la traîne. Que ce soit pour l’obtention d’un titre de séjour ou du revenu de solidarité active, les foyers d’hébergement évoquent souvent cette problématique qui explique aussi la saturation des dispositifs », observe Céline Mounier, directrice du SIAO de la Loire. Si la crise sanitaire liée au Covid-19 a permis la mise à l’abri de milliers de personnes, principalement dans des hôtels sociaux, avec pour consigne qu’aucune remise à la rue n’ait lieu, ses conséquences et celles de l’inflation sur l’équilibre économique de nombreuses familles mettent les professionnels face à des niveaux de précarité exponentiels. « Je n’ai jamais vu autant de personnes sortant de Cada dans des états de santé aussi dramatiques. Pour des raisons éthiques, il n’est pas question de choisir, nous estimons ne pas disposer des compétences. Ici, c’est l’antériorité de la demande qui joue sur la protection », déclare la directrice.
Une vision court-termiste
La coordinatrice du pôle « travail social » du SIAO parisien le confirme : « Nous observons de plus en plus de travailleurs pauvres en situation de rue alors qu’ils disposent de ressources. » Sans compter 38 000 personnes expulsées de leur logement en 2022, qui viennent s’ajouter à la convergence globale des publics vers les services d’urgence. « Des familles avec enfants en bas âge, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées ont été expulsées sans même une mise à l’abri hôtelière », déplore Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre. Les flux de perte de logement et la baisse de la construction d’habitations à loyer modéré sont autant de facteurs supplémentaires de saturation des dispositifs.
Discutées actuellement au Parlement, les prévisions pour le programme 177 du projet de loi de finances pour 2024, qui prévoit les budgets annuels du secteur, ne revoient pas à la hausse les financements. « Depuis 2017, plus de 120 000 places ont été ouvertes sur les deux dispositifs », se défend la Dihal (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement). Bien que diverses mobilisations, telle la publication d’une tribune transpartisane signée par 55 parlementaires, se joignent pour obtenir davantage de fonds, pour l’heure, aucune modification au texte n’est engagée. Pas de place non plus pour une loi de programmation pluriannuelle, qui permettrait aux acteurs de terrain de s’organiser sur le moyen terme. « Actuellement, la seule focale est la question budgétaire court-termiste, mais globalement ce sont des pertes sèches d’argent. L’investissement et la visibilité sont de réels facteurs d’économies », assure Nathalie Latour, directrice générale de la FAS.
La perte de sens
Critiquée de longue date par les associations, la gestion au « coup par coup » engendre une instabilité financière permanente. En clair, des places sont ouvertes en fonction de la tension, puis refermées quelques mois plus tard, faute de budget.
Conséquence de ce désengagement, la perte de sens est monnaie courante pour les équipes, qui deviennent responsables de situations complexes qu’elles subissent. « Nous disposons de 200 places hôtelières et, en réalité, 500 personnes les occupent. Nous allons de bout d’enveloppe en bout d’enveloppe pour essayer de combler les manques et pour économiser. Certaines places libérées ne sont pas réintégrées », explique Céline Mounier. A Toulouse, où 658 personnes ont été remises à la rue sans solution, les services déconcentrés de l’Etat financent l’ouverture d’un hébergement collectif de 200 personnes pour la période hivernale. Une nouvelle solution provisoire dans laquelle les associations hésitent à s’engager, à force d’incohérences et d’absence de considération.
>> A lire notre enquête « Hébergement d’urgence : le tri sélectif »
- 1. Tri des publics sans abri : en Auvergne-Rhône-Alpes, les professionnels en grève
- 2. Sans-domicile : l’impossible choix
- 3. Accès au logement : pas d'éclaircie en vue
- 4. Sas de desserrement : la politique des vases communicants
- 5. Hébergement d’urgence : sur le terrain, la résistance s’organise
- 6. Philippe Merlier : « Les travailleurs sociaux portent la mauvaise conscience du système »