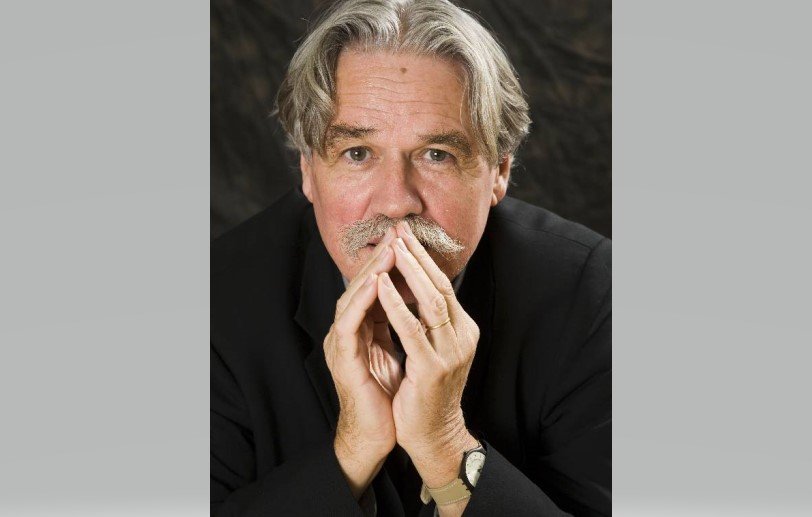Comment la sociologie clinique utilise-t-elle les histoires de vie ?
Il s’agit d’une sociologie qui s’intéresse au vécu et qui réintègre la question de la subjectivité comme approche des rapports sociaux. Dans Le métier de sociologue(1), une phrase fameuse dit en substance : « La malédiction des sciences sociales, c’est qu’elles ont affaire à des objets qui parlent. » Je dirais, moi, que la bénédiction de la sociologie clinique, c’est qu’elle a affaire à des sujets qui parlent. Nous avons été au cœur d’un grand débat, avec Bourdieu en particulier et toute une série de chercheurs, qui voulaient donner à la sociologie une consistance objective et scientifique, en mettant de côté le sujet, le désir, l’inconscient. Aujourd’hui, cette opposition paraît un peu dépassée, tant le parler de soi, le « soi » disant est devenu plus présent.
Vous avez développé une méthodologie appelée « roman familial et trajectoires sociales ». En quoi consiste-t-elle ?
A travers les groupes d’implication et de recherche où l’on invitait les personnes à venir travailler sur une thématique, leur famille par exemple, nous cherchions à mieux comprendre l’articulation entre leur histoire personnelle et les conflits qu’ils rencontraient pour analyser ensemble les rapports entre les déterminants sociaux et leur trajectoire individuelle. Notre premier séminaire s’appelait « Contradictions sociales, contradictions existentielles » – ce que j’appelle aujourd’hui les « nœuds sociopsychiques ». Dans mon ouvrage La névrose de classe, j’ai analysé comment le fait de changer de classe sociale produisait des conflits de loyauté, des sentiments de honte et de culpabilité. J’y conclus alors qu’une approche clinique, et donc biographique, par les récits de vie, est primordiale. Les individus sont des informateurs précieux des évolutions des rapports sociaux et de leur violence symbolique. J’ai été éducateur de rue auprès de jeunes qui étaient confrontés toute la journée à des humiliations. J’ai vu sur le terrain de la prévention spécialisée que les classes sociales, les violences et les souffrances sociales existaient… Les histoires de vie sont de formidables outils pour entrer dans la complexité de ces contextes familiaux et socio-historiques.
La narration est-elle forcément subjective ?
J’ai été très influencé par Henri Lefebvre, professeur de sociologie à Nanterre, qui disait : « Méfiez-vous du double piège du vécu sans concept et du concept sans vie. » Comme chercheur, c’est quelque chose qui m’a toujours influencé. Le vécu, c’est aller au plus près de l’approche subjective, de la situation des personnes, de leur contexte et de leur parcours. Le concept, c’est se donner les moyens de mieux comprendre à partir de ce qu’ils disent et de ce qu’ils vivent et d’aller au plus profond de leur éprouvé pour comprendre la société. Le récit qu’un individu peut faire de sa vie est toujours en partie fictionnel, il renvoie à des fantasmes, à son imaginaire, mais il sert aussi la réalité. Freud a montré qu’on ne raconte pas la même histoire selon qu’on est fils de berger ou de roi, fils d’ouvrier, d’aristocrate ou de grand bourgeois. Ce n’est pas le même récit objectif, mais ce n’est pas non plus le même rapport subjectif à la vie et à son histoire.
Quelles sont les conditions de production du récit dans l’intervention sociale ?
Quand on est éducateur, qu’on passe la journée au café à jouer au baby-foot avec les jeunes et qu’on se raconte, ce n’est pas du tout la même chose que pour un migrant qui fait une demande d’asile ou pour un chômeur qui sollicite une aide sociale. Dans un cas, vous avez deux sujets qui partagent, échangent sur leurs histoires respectives et, dans l’autre, cela renvoie à ce que Michel Foucault appelait la « procédure de l’aveu ». Remplir un questionnaire et parler de soi à quelqu’un qui écoute au nom d’une instance habilitée à prendre des décisions, et qui se tait. C’est de la violence symbolique. Une pratique qui est de l’ordre de la confession, de l’interrogatoire de police, lorsque les aides dépendent de la capacité de l’individu à produire un récit susceptible d’entraîner une décision. C’est un aspect dont je me méfie, car il engendre des effets pervers. Les demandeurs d’asile, par exemple, ne sont pas naïfs. Ils élaborent le récit victimaire qui est attendu. De leur côté, les travailleurs sociaux ressentent un certain malaise à devoir extirper des informations pour les objectiver et les traduire en fiches. Ils éprouvent la tension qui existe entre les exigences institutionnelles et leur désir que l’autre soit considéré comme un sujet.
Les récits de vie permettent-ils aux usagers de sortir d’un statut de victime ?
Certainement, mais les gens dont s’occupent les travailleurs sociaux sont dans des situations matérielles difficiles qu’il faut traiter en priorité. Face à quelqu’un sans travail, sans logement, sans papiers, sans revenus, on peut toujours lui faire raconter son histoire, mais il apparaît une espèce d’indécence à dire que le problème est du côté de la subjectivité. Avant d’aller au plus près de son vécu, il faut, à l’inverse, prendre d’abord en compte la réalité brute de son existence. Car le risque, avec les histoires de vie, est d’oublier les difficultés concrètes, palpables de ceux qu’on accompagne.
Un récit de vie, dès lors qu’il s’inscrit dans un accompagnement, permet-il une relation plus horizontale entre le professionnel et la personne aidée ?
Oui, mais cela demande que le travailleur social suive une formation clinique. Qu’il puisse exercer une réelle écoute, centrée sur la personne, dans un cadre de co-construction au plus près de ses besoins et de ses aspirations. Une appétence existe dans le secteur pour ce type de pratiques, mais il y a une opposition radicale entre les approches managériales, qui se sont introduites massivement dans le travail social, et l’approche clinique. Cette dernière est devenue le moyen de survivre pour les travailleurs sociaux qui sont de plus en plus maltraités, étant eux-mêmes objectivés. Ils ont de plus en plus le sentiment d’une perte de sens, de ne plus être que des administrateurs et des gestionnaires. Les récits de vie peuvent permettre de résister à ce cadre néolibéral, à la condition d’être bien conscient des déterminants sociaux. Les professionnels ont besoin de comprendre ce qu’il leur arrive, d’autant qu’ils sont pris dans des injonctions paradoxales imposées par l’institution : un discours de bienveillance, de prise en charge et d’attention aux besoins réels des individus, qui se heurte à des pratiques en complète contradiction avec cette vitrine.
(1) Le métier de sociologue, P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon et J.-C. Passeron, éd. EHESS, 2021 (nouv. édit.).