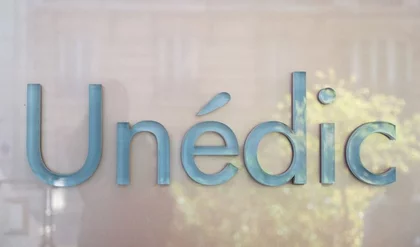Actualités sociales hebdomadaires - Pourquoi avoir lancé une recherche avec – et non sur – les jeunes des quartiers ?
Jeanne Demoulin : Le constat de départ est que les jeunes des quartiers populaires dans la recherche ou dans les médias sont plus parlés que parlants. On leur donne très peu la parole. L’image qui en ressort est une représentation faussée et incomplète, quasi figée, homogène et très stigmatisante. Selon l’idée qu’on en a, un jeune de quartier est un garçon noir ou arabe avec une capuche, un délinquant qui traîne au bas des immeubles de cités… Pour que ces préjugés évoluent, nous avons souhaité mener une recherche participative, Pop-Part, fondée sur le principe que les universitaires ne sont pas les seuls à pouv
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?