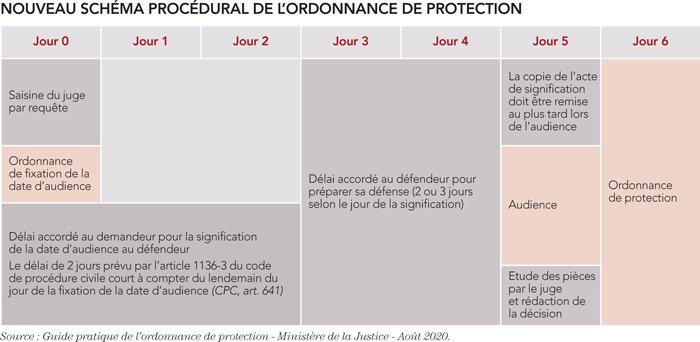Selon la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « convention d’Istanbul »), ratifiée le 4 juillet 2014 par la France, la notion de violences faites aux femmes concerne « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique ». Ainsi les violences à l’égard des femmes s’observent dans l’environnement familial mais également dans l’espace public ou dans le cadre professionnel. Elles peuvent être à la fois physiques, verbales, sexuelles, économiques ou psychologiques.
Selon l’Asse
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?