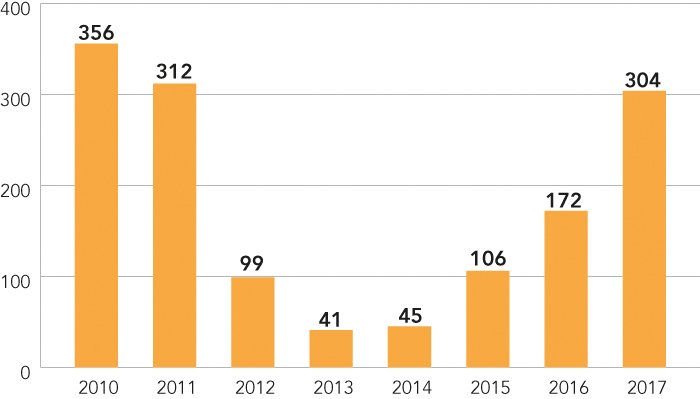« Une occasion unique » pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, et mettre un terme au « traitement inhumain et dégradant » que constitue leur enfermement : pour les seize associations qui ont interpellé les députés, le 15 novembre, l’espoir soulevé par le groupe de travail parlementaire censé formuler une proposition de loi sur la question, est immense.
A quelques jours de la Journée internationale des droits de l’enfant, les associations, dont la Cimade, Amnesty International France, ou encore France terre d’asile sont revenues sur la situation des enfants accompagnés ou non, retenus dans des lieux de privation de liberté en vue de leur expulsion. On parle ici des centres de rétention administrative (CRA), dont neuf sont actuellement habilités à rec
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?